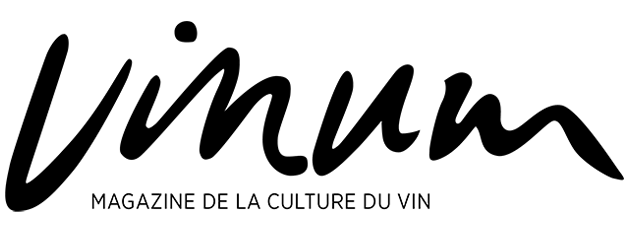Entretien avec Valentin Blattner
Le papa du Cabernet Jura
Photo: Olivier Noaillon

Un des premiers vignerons du Jura, Valentin Blattner se consacre désormais à son activité d’obtenteur de cépages résistants aux maladies. Il a déjà produit plus d’un million de pépins et d’innombrables variétés, dont le Cabernet Jura, le Sauvignac et le Pinotin.
Vous considérez-vous d’abord comme un vigneron ou comme un obtenteur de cépage?
Je suis d’abord vigneron. Après mon apprentissage, j’ai commencé à créer des cépages résistants pour moi. Les demandes sont rapidement venues de Suisse et du monde entier. Maintenant, je ne suis plus responsable du domaine. Grâce à mes projets à l’étranger, ma fille Olivia a pu reprendre les vignes sans que papa ne soit toujours autour! Avec d’autres scientifiques, nous faisons des croisements et de la sélection de cépages aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle- Zélande, en Thaïlande… Mais nos mandats les plus intéressants sont basés en France, en Allemagne et surtout en Espagne. Parce que si on veut pratiquer la viticulture avec peu de traitements et des cépages résistants, il faut aussi travailler dans des conditions favorables.
Alors, pourquoi avoir été l’un des premiers vignerons à avoir implanté votre domaine dans le canton du Jura, qui a longtemps eu des conditions difficiles pour la culture de la vigne?
Le Jura, c’est bien pour faire les sélections, parce qu’on y retrouve, en gros, toutes les maladies! Et j’ai la liberté de faire comme je veux. Quand je crée un cépage ici, il est considéré comme autochtone. Du coup, on a l’appellation contrôlée cantonale qui compte le plus de cépages autorisés.
Mais le contexte climatique évolue dans un sens favorable à la viticulture dans le Jura, non?
Les choses ont beaucoup évolué, c’est vrai. Avec le changement de climat, on peut planter de la vigne dans la plaine de Delémont, la plaine du Rhein, n’importe où. Quand j’ai créé le cépage 32-7 (Sauvignon Soyhières ou Ravel Blanc, NDLR) il y a 30 ans, il était juste idéal pour notre terroir. Maintenant, il est souvent trop mûr. Il développe de jolis arômes de Sauvignon, de fruits de la passion, de fleurs et feuilles de sureau.
Quel est le processus de création d’un nouveau cépage résistant?
On doit s’assurer qu’il y ait plusieurs gènes résistants au mildiou, à l’oïdium, mais aussi à d’autres maladies comme le black-rot. Lorsqu’on introduit un gène résistant à l’oïdium, il faut également éliminer les gènes négatifs. On ne peut pas créer des cépages résistants en ajoutant de bons gènes sans s’intéresser aux mauvais. Dans un champ de sélection, on fait plus de 200 croisements différents, parce qu’il faut trouver les bons partenaires. Sur 1000 plants-tests, la moitié va montrer une bonne résistance à l’oïdium, mais on doit encore diviser ce nombre par deux pour écarter les mauvais gènes. Il nous reste donc 250 plants, sur lesquels on va refaire le même processus pour le mildiou. Mais tous ces ceps ne produisent pas des raisins! Les fleurs qui ne sont pas hermaphrodites, qui n’ont que les organes reproducteurs femelles et pas les mâles, ne font pas de fruits. On va encore mettre de côté ces plants-là. Comme je suis viticulteur moi-même, la suite est assez simple pour moi. Je transmets les plants à mes copains et ils me disent ce qui marche et ce qui ne marche pas. C’est le viticulteur qui doit choisir; le pépiniériste donne aussi son avis. Je ne fais que leur proposer les cépages.
Comment procédez-vous pour rendre les cépages toujours plus résistants?
On ne travaille pas pour un résultat, on travaille sur un problème persistant. Il y a toujours de nouveaux problèmes, il faut les identifier et trouver des solutions. Certains champignons commencent à «faire de la résistance, contre la résistance». C’est comme avec la COVID-19, la nature n’est pas bête, surtout par les champignons, surtout pas le mildiou! On doit évoluer avec eux, c’est le jeu. On cherche toujours de nouveaux gènes résistants et on les ajoute aux cépages, tout en pensant aux enjeux qui surviendront dans dix ans.
Combien de temps faut-il consacrer à la création d’un nouveau cépage?
On pourrait sortir un nouveau cépage tous les cinq ans. C’est faisable. Le viticulteur va encore faire des tests pendant trois à quatre ans, pour qu’on puisse valider le plant. Ensuite, il faut faire toutes les démarches administratives, qui prennent le plus de temps. Je ne peux pas vendre un pied de vigne s’il n’est pas inscrit dans le catalogue européen de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin. Ça prend encore cinq ans et ça coûte 60 000 francs par cépage, réparti sur 20 ans. Pour la Suisse, il faut encore compter cinq ans de démarches administratives avec les cantons pour que les cépages soient reconnus dans les AOC.
Ces démarches administratives sont-elles compliquées?
On complique tellement les procédures avant de mettre un cépage sur le marché que le champignon a le temps de s’adapter. Il faudrait aller beaucoup plus vite. On devrait s’inspirer des pommes. Le consommateur a le choix entre les jaunes, les rouges et les vertes, et voilà ! Le reste n’a pas d’importance. C’est la même chose chez les producteurs de raisins de table, ils plantent n’importe quels cépages: des verts, des jaunes, des rouges et des bleus. Dans le détail, les cépages changent tous les trois ans.
Vous rejoignez donc ceux qui pensent qu’on ne devrait même plus indiquer le cépage sur les bouteilles?
Oui, si le style est précisé et facile à reconnaître. Personnellement, ça me donne une bonne indication qu’on me dise qu’un vin présente le style d’un Riesling. Ainsi, je m’attends à de l’acidité, à une aromatique un peu pétrolée. Je n’achèterais pas un vin si je n’ai aucune information sur ses caractéristiques. À la fin, c’est le vin qui compte.
Qu’est-ce qui vous a attiré vers les cépages résistants?
Je me suis dit, la viticulture, c’est mon truc, mais il faut changer quelque chose. Notre agriculture actuelle ne peut pas continuer comme ça à long terme. Dans certaines régions, il est déjà trop tard. Même si on arrête de traiter, il y aura toujours des résidus. Si on ne doit plus traiter, on n’abime pas les sols. Je peux dire que je sauve la viticulture. Parce que si on continue comme ça, dans 100 ans il n’y aura plus de vigne. Ça ne poussera plus. Dans la nature, il y a toujours une sélection des meilleurs. C’est ce que je fais. C’est ce qu’on doit faire. D’ailleurs, on le fait dans d’autres domaines de l’agriculture. Tous les deux à cinq ans, de nouveaux types de tournesols arrivent sur le marché. Ils sont sélectionnés pour résister aux maladies. Si on ne le fait pas, on n’a pas de tournesols.
Les nouveaux cépages peuvent-ils vraiment résister lors d’annus horribilis comme 2021?
Oui, si on combine tous les gènes résistants que l’on connaît. Mais dans ces années-là, je conseille quand même de traiter au minimum une fois dans l’année, après la floraison. Le viticulteur en Allemagne qui plante le Sauvignac doit traiter d’office deux fois pour éviter la mutation du champignon. S’il ne le fait pas et que le plant perd sa résistance, c’est foutu! Le vigneron peut simplement utiliser du bicarbonate de soude. C’est un élément naturel, qui nettoie tout. Comme si la plante faisait un «reset».
Quelle était la situation des cépages résistants à vos débuts?
Tout ce qu’il y avait il y a trente ans, c’était nul. J’ai fait beaucoup de tests pour développer mes croisements. Le cépage résistant Seyval donne beaucoup de raisins, mais le vin se montre assez neutre. On peut par contre le croiser avec des cépages aromatiques. Donc ces cépages neutres restent intéressants pour les croisements. Il fallait aussi qu’on fasse nos sélections en fonction de la qualité, comme pour le Cabernet Blanc, qui rappelle le Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande. On a vraiment pu en faire des vins de qualité exceptionnelle, dix fois mieux que nos Sauvignon Blanc. Avec le Cabernet Blanc, on a gagné des médailles. On a fait du bruit. Comme avec d’autres de mes cépages, tels que le Sauvignac et le Pinotin. Ils sont fruités, faciles à reconnaître, même si on ne les a bus qu’une fois. Ils sont assez spéciaux, mais ramènent quand même des médailles. C’est 7 grâce à cette qualité que les cépages résistants ont fait parler d’eux, pas grâce au Seyval.
Votre cépage le plus connu reste le Cabernet Jura…
Le Cabernet Jura est né à la fin des années 80, je crois que c’était en 89. On avait trois variétés différentes et on les a un peu mélangées… Mais ils ont tous les mêmes parents – un cépage géorgien et une variété de Vitis amurensis – donc ce n’était pas très grave. Il a encore des résistances, mais on devra lui ajouter d’autres gènes pour le stabiliser. Dans différentes régions, il se porte encore très bien. Mais chez nous, c’est limite, surtout sur une année comme 2021. Il a une aromatique assez caractéristique, sur les baies de sureau, avec une pointe de violette. Il est très productif, presque deux fois trop et c’est clair que ça péjore la qualité. On peut en faire un très bon rosé, mais si on veut en faire un vin rouge barriqué, par exemple, il faut travailler sur son rendement. À cette condition et en fût de chêne, il donne des vins avec de jolis tanins et une belle aromatique, dans un style bordelais, mais plus abordable. J’ai beaucoup de copains dans le Bordelais qui plantent aussi le Cabernet Jura. Il sort très bien, j’en suis étonné. On en trouve également maintenant en Scandinavie. En Norvège et en Suède, tous les vins de cuve sont des cépages résistants. Cette clientèle les connaît très bien et la demande est immense.
Vous remarquez donc que le public est prêt pour ces vins?
Il faut une évolution dans le marché. Le consommateur cherche des nouveautés. On ne peut plus faire comme on a toujours fait. Il faut travailler avec ceux qui sont déjà convaincus et tout devient facile. J’ai beaucoup de copains, tels que Roland Lenz, qui ne plantent que des cépages résistants. Parce que si on calcule bien, c’est la seule chose qui fonctionne.
Qui va continuer vos recherches lorsque vous souhaiterez vous arrêter?
J’ai personnellement hérité des recherches d’obtenteurs de cépages actifs avant moi, tels que le Français Bouquet de l’institut de Montpellier et Monsieur Becker (Helmut Becker, directeur de l’Institut de sélection et d’amélioration de la vigne de 1964 à 1989 à Geisenheim dans le Rheingau, en Allemagne, NDLR). C’est une grande responsabilité. Il faut faire preuve d’honnêteté et reconnaître que les spécialistes avant nous ont déjà beaucoup travaillé. C’est clair que de mon côté aussi, je devrai le léguer à la génération suivante. Je suis en contact avec des personnes intéressées. J’ai fondé mon entreprise, l’Institute of Ecology and Grape Breeding, il y a une trentaine d’années. Elle est dépositaire de mes créations et de mon matériel.